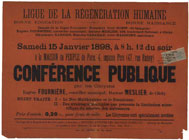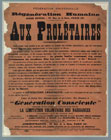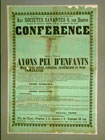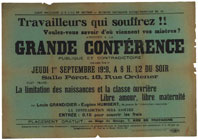Le néo-malthusianisme français présente la particularité d'avoir généralement présenté son action humanitaire et émancipatrice comme secondaire par rapport à son ambition d'être une arme de la lutte des classes et de l'édification de la société communiste future.
De ce fait, ses relations avec les diverses chapelles qui se disputaient la direction du mouvement ouvrier allèrent d'une étroite collaboration à un hostilité virulente.
Théoricien du libéralisme économique et politique, Malthus était principalement inspiré par sa volonté de s'opposer aux théories des révolutionnaires et des réformateurs sociaux. Il fut naturellement dénoncé de la façon la plus violente par la quasi totalité des socialistes utopiques du XIXeme siècle (ici Leroux et Proudhon).
Anarchisme
Les anarchistes communistes, disciples de Kropotkine, de Jean Grave ou d'Elisée Reclus furent quasi unanimes dans leur condamnation du néo-malthusianisme, "doctrine réformiste et réactionnaire". Suite au ralliement de Sébastien Faure, obtenu par Eugène Humbert, les rapports furent beaucoup plus harmonieux avec l'équipe du Libertaire. Ce fut toutefois chez les anarchistes individualistes et chez les pionniers des "milieux libres", ainsi la colonie "L'Essai" et celle de St Germain-en-Laye, que les néo-malthusiens obtinrent le soutien le plus massif.
Syndicalisme
La propagande néo-malthusienne bénéficia de la sympathie massive et très active des syndicalistes révolutionnaires, majoritaires, jusqu'à la veille de la première Guerre mondiale, dans le mouvement syndical français.
Socialisme
Aux anathèmes prononcés par les socialistes utopiques, puis par Karl Marx, à l'encontre du malthusianisme s'ajouteront les diatribes de Lénine contre les néo-malthusiens. Réformistes ou révolutionnaires, les partisans français d'un socialisme étatique et patriotique aborderont la question de la limitation volontaire des naissances avec, parfois une sympathie prudente, plus souvent un mépris emprunt de pudibonderie, majoritairement, avec hostilité.